
Il y a des douleurs qui traversent la chair comme des oracles.
Elles ne viennent pas punir, ni rappeler une faute : elles viennent révéler.
Elles se déposent dans le ventre comme une braise sous la peau, s’enroulent autour du bassin comme une ceinture de feu.
Elles font battre le sang plus fort, jusqu’à l’étourdissement.
Elles font trembler la voix, brouillent la vue, rendent le souffle court.
Elles brûlent, contractent, épuisent — et pourtant, au creux de cette brûlure, quelque chose d’infiniment vivant appelle.
Et si nos douleurs parlaient notre vérité la plus profonde ?
Ces douleurs ont leur propre parfum : un mélange de métal chaud, de terre humide et de sel.
Elles ont leur musique — sourde, répétitive, presque hypnotique — qui résonne comme un tambour à l’intérieur.
Elles parlent une langue ancienne que les médicaments ne comprennent pas.
Elles ne s’éteignent pas dans le silence médical ; elles réclament la reconnaissance du cœur.
Pendant des années, j’ai cru que mon corps était contre moi.
Je le regardais comme un animal blessé qu’il fallait dompter.
Les nuits où la douleur montait, je sentais mes entrailles pulser au rythme d’un tambour invisible,
et dans ce martèlement, il y avait quelque chose d’inexplicable — comme une mémoire qui cognait aux portes de ma conscience.
Les crampes me coupaient le souffle, des vagues de chaleur montaient le long de mes reins, la fatigue tombait sur moi comme un voile épais.
Tout avait la densité du plomb et la couleur du sang ancien.
Rien n’apaisait ce feu, ni les examens, ni les mots techniques, ni la froideur clinique.
Et puis un jour, au détour d’une séance, un kinésiologue m’a dit d’une voix calme :
« Et si ton corps disait ce que ton âme n’a plus la force de prononcer ? »
Cette phrase a fissuré la surface.
Tout s’est mis à vibrer différemment — comme si, soudain, mon propre corps me parlait dans une langue oubliée.
J’ai compris que ce que j’appelais douleur était un alphabet sacré : une suite de signaux, de sons, de frissons, de larmes et de brûlures qui racontaient l’histoire d’une femme qui ne s’était jamais entendue vraiment.
Le mal-à-dit, c’est cela : un poème gravé dans la chair.
Une prière désaccordée qui cherche la bonne tonalité.
Lorsque la bouche se tait, le ventre parle.
Lorsque le cœur retient, le sang se souvient.
Alors, j’ai commencé à écouter.
Non plus pour trouver une cause à ce mal, mais pour sentir la vérité.
Chaque douleur devenait un mot. Chaque brûlure, une mémoire.
Mon corps n’était plus un champ de bataille : il redevenait une cathédrale, fissurée mais habitée.
C’est de cette écoute qu’est né Murmures de mon âme.
Un roman, oui, mais aussi une traversée sonore, olfactive, sensorielle :
le goût du fer sur la langue, l’odeur de la pluie après la tempête, le frisson d’une vérité qui s’ouvre comme une plaie et devient lumière.
Chaque page y respire, saigne, pulse.
C’est l’histoire d’une femme — et de toutes les femmes — qui apprennent à écouter ce que leur douleur dit d’elles-mêmes.
Endométriose — le mal-à-dit des femmes qui n’ont jamais eu le droit d’exister pleinement
L’endométriose est une langue de feu.
Une braise qui se loge dans les profondeurs du ventre et s’allume sans prévenir, comme si une mémoire ancienne remontait du fond de la Terre pour réclamer son dû.
Elle brûle sous la peau, s’étend comme un serpent incandescent autour des organes, et chaque vague de douleur semble dire : “Regarde-moi. Tu ne peux plus me fuir.”
C’est une maladie que l’on nomme, que l’on classe, que l’on mesure, mais que peu savent écouter.
Parce que ce qu’elle dit ne s’exprime pas dans les chiffres, mais dans les silences.
Elle dit la vie retenue, la puissance comprimée, le cri coincé dans le diaphragme.
Elle parle pour toutes les femmes qui n’ont pas su ou pas pu prendre leur place, celles qu’on a dressées à se fondre dans les rôles, à se taire pour ne pas déranger, à être “fille de”, “mère de”, “épouse de”, “soeur de”… mais rarement “Je suis”.
Sous la douleur, il y a souvent une image :
celle d’une femme agenouillée sur le carrelage froid de sa salle de bain, respirant à peine, la peau humide, le ventre contracté, essayant de ne pas hurler pour ne pas inquiéter ceux qui dorment.
L’air y est lourd, saturé de sang et de silence.
Elle sent le fer, la cendre, la sueur.
Et dans cet espace suspendu, quelque chose en elle se fissure — une promesse non tenue, une voix qu’elle a laissée s’éteindre.
L’endométriose, c’est cette voix qui revient, obstinée.
Elle dit : “Tu m’as oubliée, et pourtant je suis ton feu.”
Elle force à s’arrêter, à reconsidérer le rythme, la fatigue, le sens.
Elle interdit la performance et exige la présence.
Elle devient une gardienne : brutale, exigeante, mais juste.
C’est une maladie du non-dit, du trop-donné, du trop-porté.
Le ventre devient un sanctuaire qu’on a profané à force d’y loger les attentes des autres.
Chaque crampe est une contraction d’âme, chaque brûlure un refus de disparaître.
Là où la médecine parle de lésions, moi j’entends des constellations de colère et de lumière.
Des particules de mémoire féminine qui refusent d’être dissoutes.
Lorsque les douleurs montaient en moi, j’avais l’impression d’accoucher d’une vérité qu’aucun mot n’avait su contenir.
Mon ventre se tordait sous le poids de générations de femmes silencieuses.
Je sentais leurs soupirs dans mes os, leurs regrets dans mes viscères, leurs désirs avortés dans mes larmes.
La douleur avait le goût du fer et du sel.
Je pouvais presque entendre, dans la chaleur sourde du bassin, les voix de celles qui n’ont jamais pu dire : “Je suis entière, même seule.”
C’est là que Murmures de mon âme a commencé à s’écrire — non pas dans un bureau lumineux, mais au creux de ces nuits rougeoyantes.
Chaque mot posé sur le papier devenait un baume, une incantation, un souffle.
Je comprenais que mon feu intérieur n’était pas mon ennemi, mais ma boussole : il me montrait tout ce que je n’avais pas encore osé incarner.
Il me rappelait que ma douleur n’était pas une faiblesse, mais une initiation.
Dans la lumière tremblante d’une lampe, entre deux respirations hachées, j’ai écrit la phrase qui a tout changé :
“Je suis ici. Et cela suffit.”
Cette phrase, je l’ai sentie dans mes veines avant de la lire sur la page.
Elle avait l’odeur du sang et du papier chaud.
Elle vibrait comme une délivrance, une déclaration d’existence adressée à la vie elle-même.
Depuis, chaque contraction, chaque brûlure, chaque fatigue me rappelle que je suis vivante,
que je porte en moi la mémoire d’un feu que des siècles de silence n’ont pas réussi à éteindre.
L’endométriose ne m’a pas brisée.
Elle m’a forcée à me rencontrer.
À comprendre que le féminin ne se définit pas par ce qu’il donne,
mais par ce qu’il ose être.
“Je suis la flamme et non la brûlure.
Je suis le feu, mais je ne me consume plus.”
Névralgie pudendale — le mal-à-dit de la sexualité exilée
La première fois que la douleur s’est manifestée, elle n’avait pas de nom.
C’était un éclair. Une morsure de feu au cœur du bassin.
Une rage de dent, mais logée dans la racine du corps — là où tout commence, là où la vie s’enracine et où le plaisir, autrefois, chantait doucement.
Le choc était si brutal qu’il coupait net la respiration.
Le monde entier semblait se rétrécir à ce point incandescent, minuscule et pourtant cosmique.
Il n’y avait pas de blessure visible.
Juste ce fil de douleur qui vibrait sans trêve, comme un fil électrique tendu entre deux mondes : celui du vivant et celui de l’oubli. Le moindre mouvement devenait une négociation avec la peur. S’asseoir, marcher, même respirer devenait un acte de courage.
Le corps tout entier se contractait pour contenir ce feu invisible, et dans le silence, une phrase revenait, acide et honteuse :
“Quelque chose ne va pas chez moi.”
La névralgie pudendale est une douleur de l’ombre.
On n’en parle pas, parce qu’elle touche ce que l’on nous a appris à cacher.
Elle habite les zones taboues : le sexe, le périnée, le bas-ventre — ces territoires du plaisir et de la vie qu’on a couverts de silence et de culpabilité.
C’est une douleur qui renvoie à la honte d’être femme, à la peur d’être perçue comme trop sensible, trop vivante, trop sexuelle, trop sauvage.
Mais dans le feu de cette douleur, j’ai compris quelque chose de fondamental :
mon corps ne me trahissait pas, il me rappelait.
Il me disait : “Tu as oublié que ton plaisir est sacré.”
Il m’invitait à revenir dans mon bassin, non pas pour jouir au sens profane du terme, mais pour me re-souvenir de ce qu’est la vie : une pulsation, une onde, un chant.
Pendant des années, j’avais associé cette zone à la honte.
Je l’avais contractée à force de retenue, de peur de déranger, de peur d’être vue.
J’avais intériorisé cette injonction invisible : sois sage, sois correcte, sois discrète.
J’avais appris à faire taire la femme qui respire depuis son ventre.
Et le corps, fidèle miroir, avait pris cette posture : celle du serrage, du repli, de la coupure.
Alors la douleur s’est installée, comme un tambour qui bat dans les profondeurs pour rappeler que la vie est faite pour circuler.
Chaque pulsation disait : “Rouvre-toi.”
Mais comment se rouvrir quand le simple contact réveille le feu ?
Comment aimer un corps qu’on craint d’habiter ?
Comment sentir sans craindre de souffrir ?
Je me souviens du jour où un ostéopathe m’a dit, les yeux doux :
“Votre bassin, c’est votre temple. Il n’a pas besoin d’être parfait, juste d’être honoré.”
Cette phrase a fait trembler quelque chose en moi.
Comme si mes cellules avaient attendu des années pour l’entendre.
Ce temple, je l’avais abandonné.
Je le voyais comme un lieu abîmé, profané, douloureux.
Mais en réalité, il n’attendait qu’une chose : que je rentre chez moi.
J’ai commencé à respirer dans mon bassin comme on allume une bougie dans une cathédrale sombre.
Doucement. Avec précaution.
J’ai appris à sentir sans juger, à toucher sans forcer, à écouter sans peur.
La douleur, d’abord, rugissait — elle ne voulait pas être ignorée, elle voulait être accueillie.
Puis peu à peu, elle s’est transformée.
Elle a pris une autre texture : plus chaude, plus ronde, plus vivante.
C’était toujours intense, mais il y avait de l’espace à l’intérieur.
Un souffle. Une prière.
“La honte est une cicatrice que le plaisir sacré vient effacer.”
Aujourd’hui, je crois que la névralgie pudendale n’est pas une ennemie.
C’est une initiation à la réconciliation.
Elle vient rappeler que la sexualité n’est pas un tabou, mais un langage divin.
Qu’elle n’est pas un acte à cacher, mais un art à célébrer.
Qu’elle n’est pas réservée à la performance, mais qu’elle appartient à la présence.
Dans Murmures de mon âme, cette réconciliation est le fil rouge.
Les mots y coulent comme une huile chaude sur les plaies du corps et de l’esprit.
C’est une œuvre écrite depuis ce lieu : le bassin comme autel, la douleur comme messagère, la voix comme offrande.
Chaque phrase cherche à rappeler que le corps est temple, que le plaisir est prière, et que la honte n’a jamais eu sa place dans la création.
Parce qu’en vérité, la femme qui se réconcilie avec son sexe se réconcilie avec la Vie.
Et la vie, elle, ne juge pas. Elle pulse. Elle respire. Elle danse.
Le corps comme autel — écouter l’âme à travers la chair
Et si le corps n’était pas un champ de ruines, mais une cathédrale en reconstruction ?
Et si, au lieu de chercher à le réparer, il fallait simplement l’écouter ?
Il n’y a pas de trahison dans la chair.
Il n’y a que des mémoires qui frappent aux portes pour qu’on les entende.
Des voix oubliées, encodées dans le sang, les muscles, les nerfs — dans les fibres de ce que nous appelons moi.
Pendant longtemps, j’ai cru qu’il fallait que mon corps “aille mieux”.
Je lui imposais du repos forcé, des cures, des traitements, des exercices, des silences.
Je le traitais comme un objet à réparer, pas comme un lieu à aimer.
Et pourtant, chaque fois que je me posais dans l’immobilité, une vibration subtile se faisait sentir : une pulsation, une présence.
C’était mon âme qui parlait à travers mes tissus.
Le corps est un autel.
Il recueille tout : les larmes retenues, les colères non dites, les élans inachevés, les désirs interdits.
Chaque vertèbre, chaque organe est une mémoire vivante.
Le cœur garde le souvenir des amours impossibles,
le ventre abrite les deuils silencieux,
la gorge enferme les paroles qui n’ont jamais pu sortir.
Et pourtant, malgré toutes ces empreintes, il continue à servir, à respirer, à créer.
Lorsque j’ai commencé à écouter mon corps autrement, j’ai perçu des choses que je n’avais jamais osé ressentir.
Sous la douleur, il y avait une chaleur.
Sous la tension, un appel.
Sous la fatigue, une sagesse immense.
Mon ventre battait comme un tambour ancestral.
Mon bassin vibrait comme une corde d’instrument qu’on accorde à nouveau après des années de silence.
Tout à coup, je n’étais plus spectatrice de ma souffrance, mais témoin de ma résurrection.
L’odeur du sang est devenue moins métallique, plus terrestre.
La douleur a pris la couleur du cuivre, du feu doux.
Dans la nuit, j’entendais presque la voix du vivant murmurer :
“Tu es la gardienne de ton temple.
Tu n’as pas à le purifier, seulement à y revenir.”
Revenir au corps, c’est revenir à la Terre.
C’est cesser de flotter dans les abstractions spirituelles pour réapprendre la densité, le poids, la matière.
C’est sentir le sol sous les pieds, l’air sur la peau, l’eau dans la bouche.
C’est comprendre que le sacré n’est pas ailleurs : il est dans le souffle, dans la pulsation, dans la fibre même du vivant.
Un jour, en méditation, j’ai eu cette vision : mon corps comme une cathédrale d’os et de lumière.
Chaque douleur y brillait comme un vitrail fissuré.
Et plus j’y laissais passer la lumière de ma conscience, plus ces fissures devenaient des portails.
Des passages entre les mondes, entre la chair et l’esprit, entre le visible et l’invisible.
J’ai compris alors que la guérison (celle dont on ne prononce plus le mot, mais dont on reconnaît la vibration)
n’était pas un retour en arrière, mais une consécration :
le moment où le corps et l’âme cessent de s’opposer pour redevenir un seul chant.
“Le corps n’est pas le tombeau de l’âme,
il en est le sanctuaire.”
Dans Murmures de mon âme, j’ai voulu écrire depuis ce sanctuaire.
Chaque phrase y a été soufflée comme une prière debout.
Les mots ne sont pas là pour expliquer, mais pour ressentir.
Ils ne promettent pas la fin de la douleur, mais l’union avec ce qu’elle veut révéler.
Ce livre est né des nuits où je parlais à mes cellules comme à des sœurs.
Je leur disais : merci d’avoir tenu, merci d’avoir parlé, merci d’avoir gardé la mémoire de ce que je suis.
Et peu à peu, quelque chose s’est apaisé.
Non pas la douleur — elle revenait encore — mais ma guerre contre elle.
Je cessais de vouloir vaincre mon corps.
Je commençais à l’aimer, même brûlant, même lent, même vulnérable.
C’est ce jour-là que j’ai su : le corps est l’autel où l’âme se rappelle à elle-même.
Et dans ce souvenir, tout redevient sacré : la peau, la sueur, les larmes, la fatigue, le souffle.
Tout devient offrande.
Reprendre sa place — du mal-à-dit à la parole retrouvée
Il y a un moment dans la traversée où le corps cesse de crier.
Non pas parce qu’il n’a plus mal, mais parce que quelque chose a enfin été entendu.
Le souffle s’élargit.
Les muscles cessent de se battre.
Une paix étrange descend dans la chair.
Ce n’est pas la fin du combat, c’est la fin de la séparation.
Pendant des années, j’ai cru que j’étais née pour supporter. Pour absorber. Pour plier sans rompre.
On m’avait appris à être forte, à ne pas trop sentir, à ne pas trop montrer.
Mais la force qu’on m’enseignait était une prison.
Et le corps, fidèle messager, m’a rappelé qu’à force de me contenir, je m’étais vidée.
J’ai compris alors que reprendre sa place, ce n’est pas la conquérir : c’est la reprendre à soi-même.
C’est arrêter de mendier le droit d’exister.
C’est dire non à l’injonction d’être gentille, sage, discrète, utile, jolie.
C’est dire oui à l’intensité, à la vérité, à la vie sans filtre.
C’est retrouver le goût du sang dans la bouche et celui du vent sur la peau.
C’est s’asseoir dans sa chair et dire : je suis ici, et cela suffit.
Lorsqu’ une femme reprend sa place, quelque chose change dans le monde.
L’air devient plus dense.
La lumière se déplace.
La terre reconnaît son pas.
Le silence n’est plus vide : il respire.
Reprendre sa place, c’est redonner au féminin son droit à la lenteur, à la profondeur, à la cyclicité.
C’est refuser la productivité comme mesure de valeur.
C’est honorer la fatigue comme un langage sacré.
C’est se rappeler que notre feu intérieur n’a pas à être utile pour être légitime.
C’est aussi — et surtout — redonner sa voix à la femme muette qui vit en nous.
Celle qu’on a réduite au rôle, au devoir, au service.
Celle qui a tant voulu plaire qu’elle s’est oubliée.
Celle qui a parlé à voix basse, en espérant ne pas déranger.
Et qui aujourd’hui, s’avance, nue, les mains ouvertes, la gorge déliée.
“Reprendre sa parole, c’est redonner un cœur à sa voix.”
Lorsque j’ai recommencé à écrire après les années d’errance, j’ai senti que chaque mot remontait depuis le bassin.
La plume n’était plus un outil, mais une veine ouverte.
Les phrases avaient l’odeur de la terre humide et le goût du métal chaud.
Je n’écrivais plus avec ma tête, mais avec mon ventre.
C’était animal, brut, vrai. Les larmes coulaient sur les pages avant même que les phrases ne soient finies.
Et c’est là, dans cette nudité absolue, qu’est né Murmures de mon âme.
Je n’ai pas écrit ce livre pour donner des réponses, mais pour rappeler que la vérité d’une femme ne s’enseigne pas — elle se retrouve.
J’ai écrit pour que celles qui lisent sentent leur propre voix vibrer à travers mes mots.
Pour qu’elles se rappellent qu’elles aussi portent une parole oubliée, qu’elles ont le droit de la dire sans trembler.
Même si elle dérange. Même si elle brûle. Même si elle ne plaît pas.
Reprendre sa parole, c’est faire le deuil du consensus.
C’est choisir la justesse plutôt que l’approbation.
C’est reconnaître que la vérité, quand elle sort du ventre, fait trembler les murs.
Mais qu’elle ouvre aussi des chemins que la peur ne pourra jamais refermer.
C’est un processus alchimique : le plomb des silences se transforme en or de présence.
Les non-dits deviennent des chants.
Les blessures deviennent des portes.
Et le corps, ce corps qu’on croyait fragile, se révèle comme le trône le plus solide du monde.
Dans Murmures de mon âme, cette réappropriation est partout.
Chaque chapitre est une marche sur laquelle une femme s’élève, non pas au-dessus des autres,
mais au-dessus des illusions qui l’ont réduite.
Ce roman est un cri contenu, devenu murmure, devenu souffle.
C’est l’histoire de ce moment où la femme ne cherche plus à survivre, mais à vivre pleinement.
“Quand la femme se souvient de sa puissance, la douleur se tait.”
Alors oui, reprendre sa place, c’est risquer d’être vue.
C’est risquer d’être incomprise, critiquée, jugée.
Mais c’est aussi — et surtout — offrir au monde la beauté d’une femme alignée.
Celle qui ne joue plus de rôle, qui ne ment plus à son corps,
qui parle depuis la racine, avec la lenteur d’un oracle et la clarté d’une source.
Et Lorsqu’ elle parle, l’univers s’incline.
Conclusion — Le corps ne trahit jamais
Le corps ne ment pas.
Jamais.
Il ne trahit pas, il ne punit pas, il ne s’acharne pas.
Il rappelle.
Il enseigne.
Il murmure avant de crier.
Et quand il crie, c’est seulement parce qu’on n’a pas su l’entendre à temps.
Sous chaque douleur, il y a une vérité enfouie.
Sous chaque tension, une parole bloquée.
Sous chaque épuisement, une âme qui frappe à la porte pour qu’on la laisse revenir.
Le corps ne cherche pas à nous punir,
il cherche à nous ramener à la maison.
Pendant des années, j’ai tenté de le fuir.
Je me suis réfugiée dans l’esprit, dans les mots, dans la quête du sens.
Je l’ai jugé, contrôlé, épuisé, dopé, rejeté.
Et lui, patient, m’attendait.
Il m’attendait dans la brûlure, dans la fièvre, dans les contractions du ventre et la fatigue de l’âme.
Il m’attendait pour me dire :
“Je ne suis pas ton ennemi, je suis ta boussole.”
Le corps parle une langue que seule la tendresse comprend.
Une langue faite de chaleur, de pulsations, de frissons.
Quand on s’y relie, tout se remet à circuler : le sang, la joie, les larmes, la mémoire.
C’est un flux, un courant, un chant.
Et quand ce chant reprend, on sent la vie reprendre aussi — jusque dans les fibres les plus anciennes, celles qui avaient oublié leur propre lumière.
Je me souviens du jour où j’ai posé la main sur mon ventre sans peur,
et que j’ai simplement dit : merci.
Merci d’avoir tenu.
Merci d’avoir parlé, même dans la douleur.
Merci d’avoir gardé la trace de ce que je suis quand je m’oublie.
Ce geste, simple en apparence, a ouvert une porte invisible.
J’ai senti une chaleur douce monter du bassin, une lumière lente envahir ma poitrine.
C’était comme si, pour la première fois, le corps et l’âme respiraient ensemble.
Ce jour-là, j’ai compris que je n’avais pas besoin de le “guérir”.
Il n’était pas cassé.
Il était simplement porteur d’un message que je refusais d’entendre :
“Reviens. Reviens à la lenteur, à la douceur, à la vérité.”
Alors je suis revenue.
Dans la chair.
Dans le souffle.
Dans la présence.
J’ai appris à aimer mes cicatrices comme des calligraphies du vivant.
À honorer mes failles comme des vitraux qui laissent passer la lumière.
À remercier mes douleurs comme des initiations.
C’est depuis cet espace que j’ai écrit Murmures de mon âme.
Chaque mot posé sur la page venait du corps.
De ses feux, de ses vagues, de ses silences.
Ce livre est une offrande à toutes celles qui ont cru que leur douleur les définissait.
À toutes celles qui ont cherché la paix à l’extérieur alors qu’elle battait déjà sous leur peau.
À toutes celles qui se sont excusées d’exister, alors que leur simple souffle est déjà prière.
“Et si ton mal disait ton appel ?
Et si ta douleur était le signe de ton retour à toi ?”
Le corps ne trahit jamais.
Il guide.
Il garde la mémoire de ce que l’âme a promis d’apprendre.
Il sait quand ralentir, quand brûler, quand fleurir.
Et quand on l’écoute enfin, il devient ce qu’il a toujours été :
un temple vivant, vibrant, palpitant de lumière et d’amour.
C’est cela que Murmures de mon âme raconte.
Le retour au corps, au souffle, au sacré.
L’instant où la douleur cesse d’être un supplice pour devenir une initiation.
Le moment où la femme cesse de se demander “pourquoi” pour simplement dire : me voici.
Et dans ce me voici, dans cette présence nue et entière, tout l’univers reconnaît la prière originelle.
Le mal-à-dit a finir par me sauver.


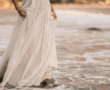











What do you think?
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.