
Etre féministe, c’est la notion que j’ai envie d’explorer dans cet article introspectif.
Le mot féminisme résonne partout aujourd’hui.
Sur les pancartes, dans les débats, dans les slogans criés à pleins poumons, dans les bannières colorées de celles qui revendiquent une place.
Et pourtant… plus il est prononcé, plus son écho semble s’éloigner de son origine.
Il vibre fort, mais creux.
Il appelle, mais parfois sans direction.
Il hurle, là où le féminin, lui, chuchote, vibre, engendre.
Je ne rejette pas le féminisme.
Je lui rends hommage, même — car sans celles qui ont ouvert la voie, je ne pourrais pas écrire ces mots aujourd’hui.
Mais quelque chose, dans les formes qu’il prend désormais, m’interroge profondément.
Je ne me reconnais pas dans les cris de guerre, dans les comparaisons, dans les colères devenues identité.
Je ne crois pas que la libération passe par la lutte.
Je crois qu’elle passe parautre chose de plus profond. De plus vrai.
Et si le vrai féminisme n’était pas une révolte, mais une réminiscence ?
Un souvenir de ce que nous avons toujours été :
créatrices, gardiennes, tisseuses, initiées.
Des femmes qui savent sans qu’on leur enseigne, qui sentent sans qu’on leur prouve.
Des femmes dont la puissance ne se démontre pas : elle se respire.
Je crois que l’époque nous pousse à confondre puissance et opposition.
À penser que pour exister, il faut se battre.
Que pour être respectée, il faut s’imposer.
Que pour être visible, il faut briller plus fort que les autres.
Mais la puissance féminine, la vraie, ne se mesure pas à la décibelle : elle se mesure à la profondeur du silence qu’elle peut contenir.
“Le féminin ne conquiert pas : il révèle.”
J’ai longtemps cru qu’il fallait prendre ma place dans le monde.
Je me suis épuisée à vouloir la mériter, à la négocier, à la défendre.
Puis un jour, j’ai compris : ma place n’était pas à prendre.
Elle était déjà là, dans la texture même de ma présence, dans le simple fait d’être.
C’est le monde qui avait oublié de la voir, pas moi qui devais la conquérir.
Alors j’ai cessé de me battre pour entrer.
J’ai commencé à créer mes propres espaces.
Des espaces où la douceur est puissance, où la lenteur est sagesse, où l’intuition est direction.
Des espaces où la femme cesse de demander la permission d’être, pour simplement se lever.
Là, dans la simplicité d’un souffle, j’ai compris que je venais de redéfinir, sans le vouloir, ma façon d’être féministe.
Ce texte n’est pas une critique du mouvement,
ni une leçon, ni un manifeste contre quoi que ce soit.
C’est une exploration.
Une invitation à revisiter le féminin en dehors des dogmes,
à sentir ce qu’il veut dire dans ton corps, pas seulement dans ton esprit.
C’est une réflexion sur ce que signifie, aujourd’hui, être femme dans un monde saturé de bruit et de pouvoir.
Je crois que nous avons assez crié pour être entendues.
Il est temps maintenant d’être écoutées.
Non plus par la peur ou la revendication,
mais par la fréquence de notre vérité.
Et cette vérité ne s’impose pas : elle se reconnaît.
“Ce texte n’est pas une arme.
C’est un miroir.”
Il n’a pas pour but de convaincre.
Il a pour but de te rappeler ce que tu sais déjà,
au creux de ton ventre, dans la mémoire de ton sang :
que la femme n’a jamais eu besoin d’être rendue égale pour être immense.
Elle a seulement besoin de se souvenir qu’elle est divine.
Quelques fois,être féministe c’est mener un combat qui éteint la lumière
Il y a une fatigue que les femmes connaissent bien.
Une fatigue ancienne, logée dans la nuque, dans les reins, dans le cœur et même dans l’âme.
Ce n’est pas celle du travail, ni celle des enfants, ni même celle des nuits trop courtes — c’est une fatigue de se battre pour exister.
Depuis des siècles, nous tenons le monde à bout de bras, souvent sans reconnaissance.
Nous portons la mémoire de nos mères, de nos grand-mères, de celles qu’on a brûlées, fait taire, oubliées.
Et, malgré tout, nous avons continué à enfanter, à aimer, à créer, à réparer.
Mais aujourd’hui, quelque chose en nous dit : assez.
Le combat perpétuel épuise la lumière qu’il voulait défendre.
À force de lutter pour prouver notre valeur, nous avons oublié que notre valeur était innée.
Nous avons accepté de jouer avec les règles d’un monde qui n’a jamais été conçu pour nous.
Nous avons intégré l’idée que pour être fortes, il fallait endosser les codes du masculin blessé : le contrôle, la performance, la justification.
Nous avons voulu montrer que nous pouvions tout faire — travailler, enfanter, aimer, guérir, diriger, survivre.
Et nous avons oublié l’essentiel : nous ne sommes pas venues pour prouver, mais pour être.
Un feu qui brûle sans cesse finit par manquer d’air.
Et quand le souffle manque, la flamme ne s’éteint pas : elle s’étouffe.
C’est ce qui s’est produit pour tant de femmes qui se sont perdues dans le combat : elles ont confondu le feu de la vie avec le feu de la lutte.
Le premier éclaire, réchauffe, inspire.
Le second consume, isole, durcit.
“Le féminin blessé croit qu’il doit lutter pour être vu.
Le féminin éveillé sait qu’il lui suffit d’être.”
Quand on agit depuis la blessure, on réagit.
On s’épuise dans la défense, on crie pour se faire entendre, on se fige pour ne plus souffrir.
C’est une énergie de survie.
Mais quand on agit depuis la conscience, on n’a plus besoin de prouver : on incarne.
Là, la puissance devient subtile, magnétique, tranquille.
C’est la différence entre la force qui frappe et la présence qui transforme.
Je l’ai expérimenté moi-même.
À une époque, je croyais qu’il fallait convaincre, démontrer, argumenter. Lutter corps et âme.
Je me battais pour être écoutée dans des espaces saturés de bruit, d’ego, d’opinions.
Je sortais de ces débats épuisée, vidée, presque absente de moi.
Et puis, un jour, j’ai compris que ma voix portait mieux quand je parlais plus bas.
Que le silence avait un pouvoir de résonance que les cris n’ont pas.
Que la vérité n’a pas besoin de défendre sa place — elle s’impose par sa vibration.
Alors j’ai arrêté de crier.
Je me suis tue.
Et dans ce silence, j’ai entendu un son que j’avais oublié :
le battement de mon propre cœur.
Un rythme simple, régulier, immuable.
Une musique qui n’avait rien à prouver.
C’est là que j’ai compris : le combat était en moi.
Combattre pour exister, c’est encore accepter qu’il y ait un adversaire.
Mais le monde dont nous rêvons n’a plus besoin de vainqueurs : il a besoin de tisseuses.
De femmes capables de relier, d’unir, de transformer, pas de séparer.
Nous ne sommes pas venues restaurer le féminin contre le masculin,
mais pour le réconcilier avec lui.
Ce que j’ai découvert en cessant la lutte, c’est que la lumière ne demande pas de permission pour briller.
Elle n’a pas besoin d’un manifeste ni d’une pancarte.
Elle s’installe, simplement, et éclaire tout sur son passage.
La femme qui agit depuis sa conscience n’a pas besoin d’expliquer sa valeur : elle la dégage.
Et c’est peut-être cela, le véritable féminisme :
non pas se battre pour être vue, mais vivre de manière si pleinement incarnée que le monde ne peut plus détourner le regard.
La lumière ne se conquiert pas. Elle se laisse traverser.
Etre féministe c’est oser réhabiliter la femme comme être divin
Réhabiliter la femme comme être divin, ce n’est pas la placer sur un piédestal.
Ce n’est pas dire qu’elle vaut plus, ni qu’elle est meilleure, ni qu’elle doit régner.
C’est se souvenir que la femme est la porte du monde,
celle par qui tout passe, tout naît, tout respire, tout recommence.
Elle est le lieu du passage entre l’invisible et la matière,
le canal par lequel la vie s’incarne.
La femme n’est pas un genre : elle est un principe.
Une fréquence originelle qui habite chaque être humain, quel que soit son sexe.
C’est la pulsation du vivant, le mouvement de la création, la matrice qui relie tout ce qui existe.
Réhabiliter la femme, c’est reconnaître en elle le visage du divin en action :
la force qui crée sans détruire, qui éclaire sans brûler, qui enseigne sans imposer.
“Le féminin divin n’a jamais cessé d’exister.
Il a simplement cessé d’être honoré.”
Pendant des millénaires, le féminin a été confondu avec la faiblesse,
parce qu’il parle la langue du mystère, du ressenti, de la lenteur, de la réceptivité.
Mais être réceptive, ce n’est pas être soumise — c’est être capable d’accueillir la totalité.
C’est contenir sans se dissoudre, recevoir sans perdre sa forme, aimer sans se nier.
La femme divine n’est pas une déesse inaccessible : elle est cette part de nous qui sait que tout a un rythme, un cycle, un sens.
Quand on parle du féminin sacré, beaucoup y voient une abstraction.
Mais c’est une réalité vivante, palpable, charnelle.
Le féminin, c’est la terre humide qui accueille la graine,
l’eau qui épouse la forme du vase,
l’air qui transporte les prières,
le feu qui transforme la matière en lumière.
C’est la respiration de l’univers elle-même.
Réhabiliter la femme comme être divin, c’est donc cesser de la réduire à ses rôles.
Ce n’est pas la mère, l’amante, la sœur, la fille, la guérisseuse — c’est tout cela à la fois et bien plus encore.
C’est l’énergie qui tisse les liens entre ces visages, qui donne sens à la multiplicité.
C’est la conscience du cycle, de la mort et de la renaissance, du repli et de l’éclat.
C’est la femme qui comprend qu’elle ne se perd pas quand elle se transforme.
Nous vivons dans un monde qui glorifie la ligne droite —
la productivité, l’efficacité, la performance, la vitesse.
Mais le féminin divin est circulaire.
Il procède par spirales, par retours, par approfondissements.
Il ne monte pas, il descend.
Il ne conquiert pas, il féconde.
Et dans ce mouvement, il rend le monde vivant.
“Le masculin construit les temples.
Le féminin y fait descendre le sacré.”
Quand une femme réhabilite le divin en elle, elle cesse de chercher la validation extérieure.
Elle ne se compare plus, elle ne rivalise plus, elle ne séduit plus pour être choisie.
Elle devient le choix lui-même.
Son autorité est naturelle, douce, inébranlable.
Elle n’a pas besoin d’armes, car elle porte la présence.
C’est cela, la souveraineté féminine :
un trône invisible, ancré dans la chair, bâti de silence et d’amour.
J’ai souvent observé cette vibration chez les femmes qui ne se revendiquent pas spirituelles.
Elles ne méditent pas, ne citent pas les déesses, ne parlent pas d’énergie —
et pourtant, elles marchent avec une dignité lumineuse.
Elles savent écouter les saisons, apaiser un regard, transformer une pièce par leur simple présence.
Elles n’ont pas besoin d’en parler : elles l’incarnent.
Et c’est peut-être cela, le plus grand enseignement :
le divin n’a pas besoin de symbole quand il est vécu.
Réhabiliter la femme comme être divin, c’est rendre à la Terre sa mémoire.
Car le féminin et la Terre sont un seul corps.
Quand l’un souffre, l’autre s’assèche.
Quand l’un renaît, l’autre reverdit.
Et tant que la femme se croira séparée du vivant, elle cherchera à l’extérieur ce qu’elle porte déjà à l’intérieur :
le pouvoir de régénération, de guérison, de création.
Alors oui, je rêve d’un monde où les femmes ne se battent plus pour exister,
mais où elles réapprennent à habiter leur propre temple.
Un monde où la spiritualité ne serait pas réservée aux élites, mais tissée dans le quotidien.
Un monde où chaque geste — préparer un repas, écrire, marcher, étreindre, semer — serait reconnu comme un acte sacré.
Un monde où la femme n’aurait plus besoin d’être divine pour être respectée,
parce qu’on aurait enfin compris que toute femme l’est déjà.
Les pièges du féminisme contemporain
Le mot féminisme a sauvé des vies.
Il a ouvert des portes, brisé des lois injustes, donné des voix à celles qu’on voulait faire taire.
Il a permis à des générations de femmes de se redresser, d’apprendre, de voter, de travailler, de choisir.
Mais comme tout mouvement né du feu, il a aussi laissé des cendres.
Et dans ces cendres, quelque chose du féminin sacré s’est éteint un temps : la paix.
Je regarde parfois les manifestations, les slogans, les cris.
Et je comprends leur nécessité — parce qu’un cri, c’est un signal de survie.
Mais je vois aussi, derrière, une douleur plus profonde : celle d’un féminin qui, à force de vouloir être entendu, s’est coupé de sa propre vibration.
Le combat a pris la place du cœur.
La revendication a remplacé la conscience.
Et dans ce glissement, la femme s’est parfois éloignée de ce qui faisait sa puissance originelle : son pouvoir d’union.
“Tant que le féminin se définit en opposition, il demeure prisonnier de la blessure qu’il veut guérir.”
Le féminisme moderne, dans sa forme la plus bruyante, s’est construit contre.
Contre l’homme.
Contre le patriarcat.
Contre les structures.
Contre la domination.
Mais chaque fois que l’on crée du “contre”, on entretient la dualité.
Et le féminin n’est pas dualité : il est totalité.
Il n’est pas confrontation : il est circulation.
Il n’est pas exclusion : il est tissage.
Cela ne veut pas dire qu’il faut se taire face à l’injustice.
Mais il faut apprendre à parler autrement —
par la vibration, par la cohérence, par la posture.
Il faut apprendre à transformer l’énergie du combat en énergie de création.
À passer du poing levé au cœur ouvert.
Parce que le vrai pouvoir du féminin, ce n’est pas de frapper : c’est de transformer.
J’ai longtemps observé comment certaines luttes, pourtant légitimes, finissent par ressembler à ce qu’elles dénoncent.
À force de vouloir être respectées, des femmes reproduisent parfois les mêmes mécanismes de domination, de jugement, de rejet.
Elles combattent l’excès du masculin en incarnant sa caricature.
Elles deviennent dures, fermées, tranchantes — et perdent, sans le vouloir, la douceur qui était leur plus grande arme.
Elles oublient que la douceur n’est pas faiblesse : elle est le signe d’une puissance maîtrisée.
Le féminin blessé dit : « Je ne veux plus souffrir. »
Le féminin guéri dit : « Je veux comprendre et créer autrement. »
Le premier construit des murs, le second bâtit des ponts.
Et c’est là, dans cette bascule, que se trouve le futur du féminisme.
Je crois que nous avons besoin d’un féminisme qui ne soit plus seulement social, mais vibratoire.
Un féminisme qui ne cherche pas à copier le masculin, mais à dialoguer avec lui.
Un féminisme qui n’ait plus peur d’aimer l’homme, ni de se laisser aimer par lui.
Car aimer n’est pas se soumettre : c’est reconnaître le divin en l’autre.
Et le féminin divin ne s’éteint pas dans l’amour — il s’y révèle.
“Nous ne voulons pas dominer les hommes.
Nous voulons qu’ils se souviennent, eux aussi, de la beauté du féminin.”
C’est là le grand oubli : la guérison du féminin passe par la réhabilitation du masculin sacré.
Car l’un sans l’autre tourne en rond.
Le féminin, seul, devient inertie.
Le masculin, seul, devient pouvoir.
Mais quand les deux se regardent avec conscience, ils redeviennent danse.
Réhabiliter la femme comme être divin, c’est donc aussi réhabiliter l’homme comme gardien du sacré.
Non pas comme maître, ni comme sauveur, mais comme allié.
Le vrai féminisme n’exclut pas : il inclut.
Il ne divise pas : il relie.
Il ne hurle pas : il inspire.
Il ne détruit pas : il féconde.
Je rêve d’un monde où les femmes et les hommes se regarderaient à nouveau comme deux pôles d’un même souffle.
Où chacun se souviendrait que la puissance n’est pas domination, mais rayonnement.
Et que le plus grand acte de résistance du féminin aujourd’hui,
c’est de continuer à aimer sans renier sa lumière.
L’éducation comme acte sacré
Tout commence toujours dans les mains d’une mère, d’un père, d’un regard posé sur un enfant.
Le monde futur ne se construira pas dans les parlements : il naîtra dans les cuisines, dans les chambres d’enfants, dans les mots murmurés avant le sommeil.
Réhabiliter la femme comme être divin, c’est réapprendre à transmettre le sacré dès la première respiration.
L’éducation n’est pas une discipline, c’est une initiation.
Chaque geste, chaque phrase, chaque silence enseigne quelque chose : comment aimer, comment se respecter, comment exister.
Mais que transmettons-nous, vraiment ?
Souvent, des injonctions.
Des peurs.
Des héritages de honte et de performance.
Nous apprenons aux filles à être sages et aux garçons à être forts ; aux unes à plaire, aux autres à ne pas pleurer.
Et ainsi, génération après génération, nous éloignons nos enfants de leur essence.
Il est temps de désapprendre.
De désobéir à ce qui rétrécit l’âme.
De réintroduire la poésie, la lenteur, la gratitude dans l’éducation.
Car enseigner à un enfant à honorer la vie, c’est déjà réparer le monde.
« Éduquer, ce n’est pas façonner ; c’est éveiller la mémoire du divin dans ce petit corps neuf. »
Apprendre aux filles à se souvenir c’est être féministe
Apprenons-leur que leur valeur ne dépend d’aucun regard.
Que leurs corps sont des temples et non des vitrines.
Qu’elles ont le droit d’être lentes, de dire non, de dire oui, de changer d’avis, de créer, de rêver.
Parlons-leur du cycle non comme d’un fardeau, mais comme d’une marée intérieure.
Faisons-leur découvrir le plaisir comme une prière du vivant : la joie d’habiter leur chair sans honte.
Offrons-leur les mots que nous n’avons pas reçus : sacré, intuition, matrice, puissance, lumière.
Montrons-leur qu’être femme n’est pas être en manque, mais en plénitude.
Apprendre aux garçons à honorer c’est être féministe
Aux garçons, il faut apprendre non pas la culpabilité, mais la responsabilité.
Leur enseigner que la force est belle quand elle protège,
que la tendresse est virile,
que les larmes lavent,
que la vraie puissance ne domine pas : elle soutient.
Leur montrer, par l’exemple, que la femme n’est pas un mystère à résoudre, mais un univers à contempler.
Qu’honorer une femme, c’est honorer la vie.
Réhabiliter la mère, la lignée, les gestes du quotidien c’est être féministe
Réhabiliter la femme comme être divin, c’est aussi rendre sa noblesse à la maternité — qu’elle soit biologique, spirituelle ou symbolique.
C’est reconnaître la mère non comme celle qui s’oublie, mais comme celle qui tient la flamme.
C’est redonner de la valeur aux gestes invisibles : préparer un repas, écouter, soigner, créer du lien.
Ces gestes sont des prières incarnées.
Ils tissent la trame du monde.
Et il n’y a pas d’éducation sacrée sans mémoire des lignées.
Raconter les femmes d’avant, leurs mains, leurs silences, leurs miracles discrets.
Rendre leur nom à celles qu’on a effacées.
Parce qu’un enfant qui connaît d’où il vient n’a plus besoin de chercher sa valeur : il l’incarne.
Des pratiques simples pour un monde nouveau, où c’est sain d’être féministe
- Commencer la journée par un remerciement.
Enseigner à nos enfants à dire merci pour ce souffle, ce soleil, cette chance d’aimer. - Nommer le corps sans honte.
Employer des mots vrais : ventre, sexe, sang, poitrine, sans détour ni gêne.
Car ce qu’on nomme avec respect devient sacré. - Créer des rituels.
Une bougie allumée avant un repas, un bol d’eau posé sur le rebord d’une fenêtre, un moment de silence ensemble avant de parler.
Ces rituels banals ouvrent la porte du sacré. - Écouter avant de répondre.
Le silence bienveillant est la première prière d’une mère.
Il apprend à l’enfant que sa parole est précieuse. - Célébrer les cycles.
Lune, saisons, croissance, anniversaires, passages : chaque étape mérite reconnaissance.
C’est ainsi qu’on restaure la conscience du rythme, perdue dans la frénésie moderne.
Éduquer dans le sacré, c’est planter des semences de conscience.
Ce que nous enseignons aujourd’hui formera le visage de la Terre demain.
Et si chaque enfant, fille ou garçon, grandit en sachant que la femme est un être divin — pas parce qu’elle enfante, mais parce qu’elle incarne la vie — alors plus aucun combat ne sera nécessaire.
« Le monde changera le jour où nous cesserons d’éduquer des enfants, pour commencer à éveiller des âmes. »
Vers un nouveau paradigme : créer sans permission
Il vient un moment où le féminin éveillé ne cherche plus à convaincre.
Il crée.
Il enfante des mondes à partir du silence.
Il cesse de demander la permission d’exister pour commencer à bâtir ce qu’il rêve de voir vivre.
Réhabiliter la femme comme être divin, c’est refuser le rôle de spectatrice.
C’est descendre dans la matière avec conscience.
C’est dire : Je ne veux pas seulement parler de sacré, je veux le faire exister dans ma vie.
“La femme qui crée sans permission réécrit l’histoire du monde à la première personne. C’est ça aussi être féministe”
Nous avons longtemps attendu que d’autres structures nous accueillent.
Une validation, un titre, une opportunité.
Nous avons frappé à des portes qui n’étaient pas faites pour nous,
oubliant que nous pouvions construire nos propres temples.
Mais le féminin divin n’attend pas l’autorisation : il agit depuis la certitude intérieure.
Il sait que la création est son langage naturel.
La femme créatrice n’a pas besoin d’un contexte favorable.
Elle sème dans les fissures, elle fait pousser des fleurs entre les pavés.
Elle écrit la nuit, elle tisse le jour, elle parle à la lune, elle invente des espaces qui guérissent simplement parce qu’ils existent.
Sa vie devient un rituel, son travail une offrande, sa voix une onde qui se répand dans les consciences.
Créer, c’est se souvenir que l’on est source
Chaque acte de création, aussi modeste soit-il, est une reprise de pouvoir.
Peindre, écrire, cuisiner, jardiner, enseigner, élever, parler, aimer — tout cela est création.
Il ne s’agit pas de grandeur visible, mais de présence vivante.
Créer, c’est dire : Je participe à la danse du monde.
C’est répondre à la vie par un geste, une idée, une vibration.
Quand une femme s’autorise à créer, elle cesse de chercher à plaire.
C’est être féministe aussi.
Elle sort du “qu’en-dira-t-on” pour entrer dans “ce que je ressens vrai”.
Elle ne produit pas pour performer, elle engendre pour transmettre.
Son œuvre, quelle qu’elle soit, porte sa fréquence.
Et cette fréquence agit : elle réveille, elle adoucit, elle élève.
“Créer n’est pas un privilège, c’est une mémoire qui s’éveille.”
Retrouver la souveraineté du quotidien c’est être féministe
Le féminin divin n’est pas qu’une posture spirituelle : il est un choix quotidien.
Celui de ne plus s’excuser d’être lente, sensible, passionnée, intuitive.
Celui de ne plus s’adapter à des cadres étroits pour être validée.
Celui d’incarner la sagesse du corps, même dans les espaces où le mental règne.
Quelques pratiques simples peuvent tout changer et honorer le fait d’être féministe :
- Parler avec le cœur, même dans le monde professionnel.
Introduire la nuance, la douceur, le silence.
Car la douceur est un acte politique, dans une société qui valorise la dureté. - Honorer ses rythmes.
Ne plus craindre les jours d’intériorité.
Travailler quand la vague de feu monte, se reposer quand la mer se retire.
La productivité féminine est cyclique, pas linéaire. - Créer des cercles plutôt que des hiérarchies.
Appeler, relier, co-créer.
Le leadership féminin est inclusif : il élève avec, jamais contre. - Oser dire non sans se justifier.
Chaque “non” aligné devient une bénédiction silencieuse pour le monde. - S’entourer de beauté.
Fleurir sa table, allumer une bougie, s’habiller avec conscience, même seule.
Ces gestes simples rappellent au corps qu’il est temple.
Chaque fois qu’une femme choisit la cohérence, elle reprogramme la matrice collective.
Chaque fois qu’elle se traite avec respect, elle élève la fréquence du monde.
Chaque fois qu’elle crée, même en secret, elle rend le monde plus respirable.
La puissance tranquille du féminin incarné
Ce nouveau paradigme n’oppose pas l’ombre et la lumière : il les marie.
Il reconnaît la blessure, mais refuse de s’y enfermer.
Il honore la douleur, mais choisit la vie.
Il ne cherche plus à avoir raison, mais à être vrai.
La femme qui agit depuis cet espace ne détruit rien : elle transforme tout. C’est aussi comme ça, être féministe.
Elle ne revendique pas : elle manifeste.
Elle ne se débat pas : elle danse.
Son existence même devient un acte de foi.
“Une femme peut être féministe lorsqu’ elle ne réclame pas le trône, mais le construit sous ses pieds.”
Créer sans permission, c’est peut-être cela, le cœur du nouveau féminisme :
un féminisme créateur, spirituel, incarné, où chaque femme devient gardienne de sa propre réalité.
Un monde où le sacré n’est plus un concept, mais une manière d’être.
Un monde où la beauté, la lenteur et la conscience ne sont plus un luxe, mais un engagement.
Comme vous le constatez par le biais de cet article, être féministe ce n’est peut-être pas ce que vous en pensiez initialement….
Conclusion : Quand la femme se souvient, le monde se redresse, c’est peut-être ça finalement être féministe
Quand la femme se souvient, la Terre soupire.
Le vent change de direction.
Les eaux anciennes se remettent à couler sous la croûte sèche des civilisations fatiguées.
Et quelque part, dans les os du monde, un battement oublié reprend.
La femme qui se souvient ne se dresse pas contre, elle s’élève avec.
Elle ne cherche plus à prouver : elle incarne.
Elle n’attend plus qu’on l’autorise : elle se souvient qu’elle est la permission.
Parce qu’au fond, elle ne revendique pas le pouvoir — elle se rappelle qu’elle en est la source.
Quand la femme se souvient, elle n’a plus besoin de se défendre.
Elle devient la preuve vivante que l’amour est une force politique.
Elle marche pieds nus sur les ruines du patriarcat sans haine, sans gloire, sans revanche.
Elle sème des graines dans les fissures et attend que la pluie fasse le reste.
Elle sait que sa mission n’est pas de gagner, mais de réconcilier.
Le monde ne sera pas sauvé par la compétition des forces,
mais par la cohérence des présences.
Et la présence d’une femme alignée est une prière en mouvement.
Elle rééduque le regard, elle adoucit les mots, elle réveille le sacré là où tout semblait mort.
Elle n’a pas besoin de convaincre : elle rayonne, et c’est assez.
« La révolution du féminin n’est pas une guerre.
C’est une germination.
Et les racines sont déjà à l’œuvre. »
Nous vivons un temps charnière — celui du retour des grandes mémoires.
Le féminin n’est pas une mode : c’est un rappel.
Un rappel que la création, l’intuition, la compassion et la lenteur sont des forces.
Que l’incarnation n’est pas un fardeau, mais une voie d’éveil.
Que chaque douleur peut devenir passage, chaque silence enseignement, chaque amour un temple.
Quand la femme se souvient, le monde se redresse parce que la vie retrouve son axe.
La femme est cet axe.
Non pas celle qui domine, mais celle qui maintient.
Celle qui relie le ciel et la terre, l’âme et la matière, l’enfant et l’ancêtre.
Et lorsqu’elle se tient debout dans cette conscience, même le chaos s’incline.
Alors oui, peut-être que le vrai féminisme n’est pas celui qu’on crie, mais celui qu’on incarne.
Celui qui fait du pain et des poèmes avec la même ferveur.
Celui qui parle au monde avec douceur mais fermeté.
Celui qui réenchante sans fuir la réalité.
Celui qui, jour après jour, fait de sa vie un autel discret où se déposent la beauté, la vérité et le courage.
“Lorsqu’ une femme se souvient de qui elle est,
le monde se souvient de ce qu’il peut devenir.”
Et si tout commençait simplement ici — dans le corps, dans le souffle, dans la présence —
par une seule phrase murmurée :
Je n’attends plus.
Je me souviens.
Et je crée. C’est ça être féministe en 2025
Ne repars pas tout de suite.
Ferme les yeux.
Respire.
Laisse descendre une phrase de ce texte en toi.
Quelle part de toi a vibré, brûlé, pleuré ou souri ?
C’est elle qui te montre le chemin.
Et si tu veux continuer à marcher avec moi, rejoins ma Newsletter ICI



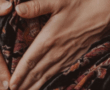
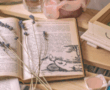










What do you think?
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.