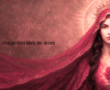Nous vivons une époque saturée, complexe. J’ai cette impression que nous sommes dans une période où le vacarme du monde essaie encore d’étouffer l’appel et l’énergie de l’âme. Un soir il y a quelques années, je me suis dite: » j’aimerais tant réenchanter le monde, un mot à la fois ». Sans penser qu’aujourd’hui, je serais complètement engagée dans cette merveilleuse mission.
Les écrans ne s’éteignent plus, les mots se déversent comme des tempêtes, et dans cette marée d’informations, quelque chose de précieux s’est égaré : le sens.
Chaque jour, nous sommes happés par le bruit du monde — guerres, crises, injustices, discours politiques déguisés en vérités. Les polémiques s’entre-choquent, les algorithmes nourrissent les colères, et les consciences s’épuisent. Il devient difficile de discerner le vrai du faux, le juste du spectaculaire, le sacré du marketing spirituel.
Tout semble s’exprimer, et pourtant plus rien ne résonne.
Et dans ce vacarme, beaucoup d’âmes sensibles — celles qui cherchent le sens, la beauté, la profondeur — se sentent étranglées.
Elles regardent autour d’elles et ne trouvent que des contenus qui crient, qui accusent, qui séduisent ou qui manipulent. Même la spiritualité, si souvent, s’est vue réduite à un produit : des citations pré-mâchées, des rituels copiés, des voix sans ancrage.
On parle d’“éveil”, de “lumière”, mais rarement de traversée, de présence, de souffle.
Alors, beaucoup se taisent.
Elles ferment les yeux, éteignent leurs téléphones, s’éloignent du tumulte — non par indifférence, mais parce qu’elles sentent que leur âme a besoin d’air.
Elles aspirent à autre chose : à des mots qui respirent, à des voix qui portent encore la trace du vivant.
Elles veulent des récits qui ne jugent pas mais qui relient, qui n’imposent rien mais rappellent l’essentiel.
Elles cherchent des paroles qui guérissent la vision, qui redonnent à la Terre et aux êtres la dignité d’exister autrement.
Alors, un jour, j’ai su.
Pas comme une révélation soudaine, mais comme un souvenir qui remonte doucement à la surface :
je ne suis pas ici pour dénoncer, je suis ici pour réenchanter le monde. A ma toute petite et humble échelle.
Non pas pour inventer des contes qui fuient la réalité, mais pour rappeler ce que nous avons oublié :
le lien, la beauté, le souffle, la lumière.
J’ai compris que c’était là ma façon d’aimer cette incarnation que j’ai la chance d’expérimenter.
De réanchanter le monde, mot par mot.
De lui rendre un peu de sa poésie.
De lui redonner un visage plus sacré.
J’ai compris que réenchanter le monde, ce n’est pas nier l’ombre — c’est lui tendre une lampe.
Et qu’écrire pouvait devenir une forme de prière active : un dialogue entre le visible et l’invisible, entre la douleur et la splendeur.
Alors j’ai pris ma plume comme on prend un engagement.
Et j’ai choisi.
J’ai choisi de réenchanter le monde, mot après mot.
Pas par espoir de changer les autres, mais pour continuer à respirer juste, à parler vrai, à me souvenir que la beauté est encore possible — et qu’elle commence toujours ici, dans le verbe qui s’élève du cœur.
Pour ouvrir la voie à d’autres conteuses, pour venir équilibrer l’égrégore de peurs, de violences, de haines avec de l’amour, du vrai, avec une vibration qui vienne contrecarrer le mauvais.
C’est là que naissent les nouvelles conteuses, comme moi.
Elles ne parlent pas plus fort — elles parlent plus vrai alors qu’on a appris aux femmes de se taire, de se faire petites.
Elles ne s’imposent pas — elles s’accordent au rythme du monde.
Elles écrivent depuis leurs chairs, leurs silences, leurs intuitions. Elles n’offrent pas des vérités, mais des tremplins vers la mémoire de l’âme.
Leur écriture n’est pas décorative : elle est réparatrice.
Chaque mot devient un fil d’amour, chaque phrase une pierre posée dans le chaos pour tracer un chemin vers le cœur.
Parce qu’il ne suffit plus de dénoncer.
Parce qu’il faut maintenant réenchanter.
Réenchanter, cela ne veut pas dire ignorer la souffrance.
Cela veut dire refuser de la laisser gouverner le monde.
C’est choisir de parler à la beauté même au milieu du fracas.
C’est croire encore en la puissance de l’imaginaire, en la douceur comme force politique, en la poésie comme acte de résistance.
C’est se tenir debout, plume à la main, face aux ruines, et dire : « Je crois encore en l’humain. Je crois encore au sacré. Je crois encore au pouvoir des histoires qui relient. »
Les nouvelles conteuses ne fuient pas la réalité : elles la transforment.
Elles savent que les mots ont une vibration, que chaque texte peut nourrir un égrégore de paix, d’équilibre et d’amour.
Et c’est cela, leur vraie mission : créer du beau pour rééquilibrer le monde.
Planter, dans les champs brûlés du désenchantement, les graines d’une conscience nouvelle.
Alors, si toi aussi tu sens cette fatigue du vacarme, cette nostalgie du vrai, ce besoin de respirer au-delà du flux — reste ici un moment.
Laisse les mots redevenir des offrandes.
Laisse-toi rappeler que chaque histoire peut être un temple, chaque plume une prière, et que le réel lui-même attend qu’on le réenchante.
Lorsque la parole a perdu de sa beauté
Il fut un temps où les mots étaient vivants.
Ils portaient le poids du monde et la douceur des prières.
Ils servaient à tisser, à relier, à bénir.
Mais aujourd’hui, la parole s’est affadie, vidée de son souffle. Elle se répand partout, mais elle ne touche plus.
Nous sommes entrés dans l’ère du verbe pressé — celui qui s’étale sur les écrans, s’épuise en slogans et se travestit en “contenu”.
Les mots s’entrechoquent, s’usent, se répètent, se vident de leur sens.
On parle pour remplir le silence, pour exister dans le flux, pour ne pas disparaître.
Mais plus la parole se multiplie, plus elle perd sa vibration.
Les mots sont devenus fonctionnels : ils n’ouvrent plus le cœur, ils instruisent, ils commandent, ils vendent.
Et dans ce brouhaha, la profondeur meurt doucement.
Le sacré, lui, se tait.
Je le vois partout — dans les conversations superficielles, dans les titres racoleurs, dans les phrases calibrées pour plaire.
La parole est devenue rentable.
Et dans cette logique de marché, le mystère n’a plus sa place.
On a transformé la parole en marchandise, l’écriture en performance, la voix en stratégie.
Mais le monde ne manque pas de mots : il manque de verbes habités.
De phrases qui respirent.
De mots qui vibrent du dedans.
De paroles qui se souviennent de leur source.
Lorsque la parole perd son ancrage, elle devient une arme ou un produit.
Et c’est cela, le grand drame de notre époque : nous avons oublié que les mots façonnent le monde.
Qu’ils ne sont pas innocents.
Qu’ils sont des ondes, des fréquences, des résonances.
Et qu’un mot posé sans conscience peut désaccorder tout un champ, comme une fausse note dans une symphonie cosmique.
J’ai longtemps observé ce désenchantement.
Cette manière dont la parole s’est coupée de son origine sacrée — le souffle.
Le souffle qui crée, qui appelle, qui nomme.
Dans la Genèse, dans chaque tradition ancienne, tout commence par un Verbe.
Mais ce verbe-là n’était pas bavard.
Il était créateur.
Il ne cherchait pas à séduire.
Il manifestait.
Alors je me suis demandé : que deviendrait notre monde si les mots redevenaient prières ?
Si écrire redevenait un acte d’âme, pas un acte de visibilité ?
Si parler redevenait un pont, pas une vitrine ?
C’est peut-être là, dans ce retour au verbe vivant, que commence le réenchantement du réel.
Quand la parole cesse d’être une information pour redevenir une invocation.
Quand elle ne sert plus à convaincre, mais à rappeler.
Rappeler la beauté.
Rappeler la présence.
Rappeler que tout mot peut encore porter la lumière — s’il est dit avec conscience.
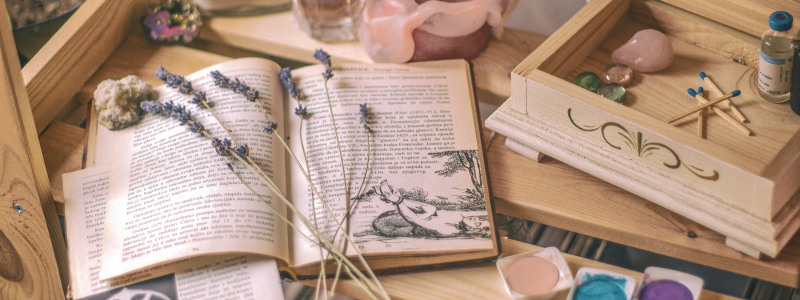
Les conteuses d’aujourd’hui : gardiennes du sacré
Je crois profondément que les nouvelles conteuses ne naissent pas d’autre chose que d’un appel de l’âme.
Elles surgissent là où le monde a oublié d’écouter.
Elles ramassent, une à une, les paroles tombées, les silences brisés, les fragments de sens abandonnés sur les chemins du désenchantement.
Elles ne parlent pas plus fort que les autres.
Elles parlent autrement.
Elles parlent depuis la chair, depuis la faille, depuis la respiration fragile de l’humanité.
Elles ne cherchent pas à convaincre ; elles cherchent à rappeler.
À rappeler que les mots ne sont pas que des outils, mais des porteurs d’âme.
Qu’un texte peut ouvrir un portail.
Qu’un poème peut devenir un autel.
Être conteuse aujourd’hui, c’est marcher entre deux mondes.
C’est vivre dans le réel – ce réel plein de poussière, de contradictions et de douleur –
et pourtant tendre, encore, vers le sacré.
C’est écrire non pour fuir, mais pour relier ; non pour adoucir la réalité, mais pour lui redonner une âme.
Ces femmes – et ces hommes aussi, car le souffle du sacré ne connaît pas de genre – ne se réclament pas d’un titre.
Elles sont tisseuses de sens, guérisseuses de regard, gardiennes du verbe.
Elles avancent dans la nuit avec la seule lumière qu’elles possèdent : leur écoute.
Elles savent que la vraie puissance n’est pas dans la démonstration, mais dans la présence.
Qu’il suffit parfois d’une phrase juste, d’un mot respiré avec amour, pour réaccorder un cœur au monde.
Elles savent que l’écriture n’est pas un métier, mais un ministère invisible :
un service rendu à la beauté, à la mémoire, à la vie elle-même.
Les conteuses d’aujourd’hui sont les héritières des prêtresses du verbe, des poétesses, des mystiques et des sages qui, dans chaque civilisation, ont parlé pour que l’humain se souvienne de lui-même.
Elles écrivent dans la continuité d’une lignée silencieuse : celles qui, depuis toujours, déposent du sens là où le vide s’installe.
Leur parole est un acte d’amour.
Elles savent que chaque mot peut devenir un baume.
Et que même dans le vacarme des réseaux, dans les tunnels de l’instantané, il reste possible de semer du sacré. De glisser, entre deux scrolls, un souffle qui dit : souviens-toi.
Être conteuse, aujourd’hui, ce n’est pas un rôle romantique.
C’est un engagement.
Celui d’habiter le monde autrement.
D’écrire avec la conscience que tout ce que l’on pose dans la matière porte une fréquence, et qu’à travers nous, c’est le vivant lui-même qui s’exprime.
Nos mots deviennent des graines.
Et si nous choisissons bien le sol – celui du vrai, du juste, du beau – alors le monde peut recommencer à fleurir.
Créer un égrégore de beauté et de vérité
Il existe, dans les mondes invisibles, des champs tissés par nos paroles.
Chaque mot que nous prononçons, chaque texte que nous écrivons, chaque pensée que nous entretenons, s’ajoute à une trame collective.
Cette trame porte un nom ancien : l’égrégore.
Un champ d’énergie nourri par la somme de nos intentions, conscientes ou non.
Nous avons appris à parler sans penser à ce que nous semons.
Nous avons oublié que le verbe agit — toujours.
Qu’il façonne, qu’il attire, qu’il relie ou qu’il sépare.
Chaque mot est une onde.
Chaque phrase, un souffle qui voyage au-delà de nous.
Quand j’ai commencé à comprendre cela, j’ai vu autrement la responsabilité d’écrire.
J’ai cessé de publier pour “exister” et j’ai commencé à écrire pour vibrer juste.
Car la beauté, quand elle est offerte avec pureté, n’est pas vaine : elle réinforme le monde.
Elle réharmonise les espaces où la peur s’était installée.
Elle redonne au réel une fréquence de vérité.
Créer un égrégore de beauté, c’est refuser de nourrir les basses fréquences du désespoir.
C’est choisir, en pleine conscience, de répondre à la laideur non par la fuite, mais par la création.
C’est tendre un mot comme on tend la main, pour rappeler qu’il reste des lieux de douceur dans la conscience humaine.
Chaque fois qu’une femme écrit depuis l’âme,
chaque fois qu’un homme prie sans témoin,
chaque fois qu’un artiste choisit la vérité au lieu du spectacle,
le tissu du monde se répare un peu.
Il se souvient.
Nos mots ne sont pas isolés — ils voyagent.
Ils se reconnaissent, s’attirent, se rejoignent quelque part, dans un espace sans frontière, et tissent ensemble un champ lumineux.
C’est cela, l’égrégore de beauté :
la rencontre de toutes les consciences qui ont choisi de ne plus écrire contre le monde,
mais pour lui.
Écrire ainsi, c’est contribuer à une œuvre invisible.
C’est semer la foi sans religion, la paix sans propagande, la lumière sans décor.
C’est croire qu’un texte juste peut adoucir un cœur, qu’une prière sincère peut apaiser une guerre intérieure, et que la somme de ces gestes infimes finit par transformer la trame collective.
Je ne crois pas à la neutralité du verbe.
Un mot posé avec amour a une vibration plus puissante qu’un discours crié dans la peur.
Et si des milliers de plumes choisissaient, ne serait-ce qu’un instant, d’écrire depuis la beauté,
le monde changerait — imperceptiblement d’abord, puis inévitablement.
Créer un égrégore de beauté et de vérité,
c’est œuvrer au niveau de l’âme collective.
C’est réapprendre à bénir au lieu d’accuser.
C’est tisser de la clarté au cœur de la confusion.
Et c’est comprendre que l’écriture sacrée n’est pas un art du passé :
c’est une technologie du vivant, une manière d’équilibrer le chaos par la vibration du beau.
Alors oui, écrire peut sembler inutile dans un monde en feu.
Mais je crois, au contraire, que c’est là que cela devient le plus nécessaire.
Parce que sans beauté, l’humanité s’éteint de l’intérieur.
Parce que sans poésie, la vérité se déforme.
Et parce que sans parole consciente, plus rien ne se relie.
Réenchanter le monde : un acte politique de l’âme
Réenchanter le monde n’est pas un luxe poétique.
C’est une nécessité vitale.
Un geste de survie spirituelle dans un temps où l’humain se coupe peu à peu de son propre souffle.
Beaucoup croient que la poésie, la beauté, la lenteur, la prière… sont des douceurs inutiles dans un monde en crise.
Mais c’est tout le contraire : elles sont les dernières formes de résistance qui ne détruisent rien.
Réenchanter le réel, c’est choisir de participer autrement.
Pas dans le vacarme des revendications, mais dans la vibration du sens.
Ce n’est pas refuser la réalité, c’est la regarder autrement — avec les yeux du cœur éveillé.
C’est marcher dans la même rue que tous, mais en y voyant encore la lumière entre les pavés.
C’est lire un fait divers et y percevoir l’appel d’une humanité qui a soif d’amour.
C’est répondre à la peur sans devenir son écho.
Le monde actuel nous apprend à nous indigner plus vite qu’à aimer, à produire plus qu’à contempler, à parler plus qu’à écouter.
Mais la véritable révolution de conscience ne se fait pas à coups de poings.
Elle se fait à coups de présence.
Elle se fait quand une femme allume une bougie au lieu de juger,
quand un homme choisit de pardonner au lieu d’argumenter,
quand un écrivain décide d’écrire pour élever, pas pour convaincre.
Réenchanter le réel, c’est réhabiliter la tendresse comme puissance politique.
C’est comprendre que l’amour n’est pas un concept mièvre, mais une force de transformation silencieuse.
C’est incarner la beauté, la bonté, la clarté, même quand le monde semble s’en moquer.
Car à chaque fois qu’un être humain choisit la conscience, il réécrit les lois invisibles du collectif.
Ce n’est pas un engagement spectaculaire.
C’est une politique du sacré, intime, quotidienne, souvent invisible.
Elle commence dans le regard que tu poses sur les autres, dans le soin que tu mets à parler, dans la qualité de ton silence.
Elle ne cherche pas à dominer, mais à accorder.
Elle ne crée pas de partis, mais des cercles.
Elle ne brandit pas de drapeaux, mais des offrandes.
Réenchanter le réel, c’est cesser de demander la permission de croire encore en la beauté.
C’est refuser de se durcir pour s’adapter.
C’est choisir de bâtir, en pleine tempête, un espace intérieur où la lumière n’est pas négociable.
C’est répondre au cynisme par la poésie, à la haine par la vérité vibrante, au désespoir par une prière incarnée.
Car oui, écrire est un acte politique — mais un politique de l’âme, un art de la reliance, un engagement du cœur au service du vivant.
Et si tu tends bien l’oreille, tu l’entends, ce mouvement souterrain : des milliers de voix se lèvent, non pour imposer, mais pour réaccorder, pour réenchanter le monde.
Réenchanter, c’est cela :
un mouvement du souffle vers la lumière.
Un art de transformer le plomb des peurs en or de conscience.
Un choix d’aimer, encore, dans un monde qui a oublié comment.
Et si c’était cela, au fond, la plus grande révolution possible ?
Écrire depuis l’âme : pour une nouvelle humanité du verbe
Écrire, aujourd’hui, ce n’est plus seulement raconter.
C’est rappeler.
Rappeler à l’humain ce qu’il a oublié de lui-même.
Rappeler que la parole n’est pas un décor, mais un feu.
Rappeler que les mots, quand ils sont vrais, sont vivants.
Quand j’écris, je n’essaie plus d’avoir raison.
Je cherche à vibrer juste.
J’écoute avant de parler.
Je laisse le silence me traverser jusqu’à ce qu’un mot émerge, simple, nécessaire, comme une respiration du monde.
Car l’écriture n’est pas une fuite de la réalité : c’est une manière de la consacrer.
Écrire depuis l’âme, c’est oser poser des mots qui tremblent.
C’est parler sans armure, sans posture, depuis la nudité du cœur.
C’est ne pas chercher à produire, mais à offrir.
C’est écrire comme on tend la main, comme on allume une bougie, comme on prie.
Sans témoin, sans attente, simplement parce qu’on sait qu’un mot juste peut, quelque part, rallumer une conscience.
Je crois qu’une nouvelle humanité du verbe est en train de naître.
Une humanité qui parle moins pour convaincre et davantage pour relier.
Une humanité qui redécouvre la puissance du verbe comme vibration créatrice.
Parce qu’avant d’être un outil de communication, la parole est un souffle divin.
Et chaque fois que nous parlons depuis l’amour, nous ramenons un peu de ciel sur Terre.
Peut-être que l’avenir du monde ne dépendra pas de nos discours, mais de la qualité de nos mots.
De la tendresse qu’ils contiennent.
De la conscience qu’ils portent.
De la vérité qu’ils osent.
Car le verbe n’est pas un luxe pour rêveurs — il est la matière première du réel.
Chaque mot que nous prononçons devient une graine dans le champ collectif.
À nous de choisir si nous voulons semer de la peur ou de la lumière.
Alors, j’écris.
Parce que je ne sais pas faire autrement.
Parce qu’écrire, pour moi, c’est prier à voix nue.
C’est aimer le monde sans conditions.
C’est me souvenir que tout ce que je nomme devient un peu plus vivant.
Peut-être qu’un jour, on oubliera mon nom.
Mais si mes mots ont pu, ne serait-ce qu’un instant, adoucir la dureté du réel, rappeler à quelqu’un la beauté d’être ici, alors j’aurai accompli ma part.
Réenchanter le monde, ce n’est pas un projet — c’est une posture.
C’est un choix d’âme.
C’est une fidélité à la lumière, même quand elle vacille.
Et si nous étions, toutes et tous, des conteurs de ce monde qui vient ?
Si chaque mot devenait une prière, chaque page un autel, chaque lecture un seuil ?
Alors, le monde se souviendrait.
Et la beauté, humblement, referait son nid dans le cœur des humains.
Réenchanter le monde, mot par mot: ma conclusion
Le monde n’a pas besoin de plus de certitudes.
Il a besoin de plus de présence.
De mots qui respirent, de gestes habités, d’âmes qui se souviennent du feu sous la cendre.
Chaque fois qu’un être humain parle depuis la tendresse, chaque fois qu’une plume ose la vérité nue,
chaque fois qu’un silence devient prière, le réel se réaccorde un peu. Un petit pas pour réenchanter le monde.
Alors, que nos mots soient des offrandes, nos textes des encens, nos souffles des chants.
Et que, dans ce grand vacarme de l’époque, nous soyons celles et ceux
qui réenchantent le monde — doucement, simplement, mot après mot.
Si toi aussi, tu sens cette fatigue du vacarme, si tu rêves d’un monde où les mots guérissent au lieu de blesser, si ton âme cherche encore des espaces où le beau et le vrai respirent ensemble — alors rejoins le mouvement silencieux de celles et ceux qui choisissent d’écrire, de parler, de créer autrement.
Pas pour fuir le monde, mais pour y semer du sens. C’est commence par ça, pour moi, réenchanter le monde.
Lis, partage, transmets, écris à ton tour.
Fais de ta parole un pont.
De ta voix, une offrande.
De ton souffle, un acte d’amour.
Car chaque mot posé avec conscience change quelque chose, quelque part.
Et c’est ainsi, humblement, que nous réenchantons le monde.